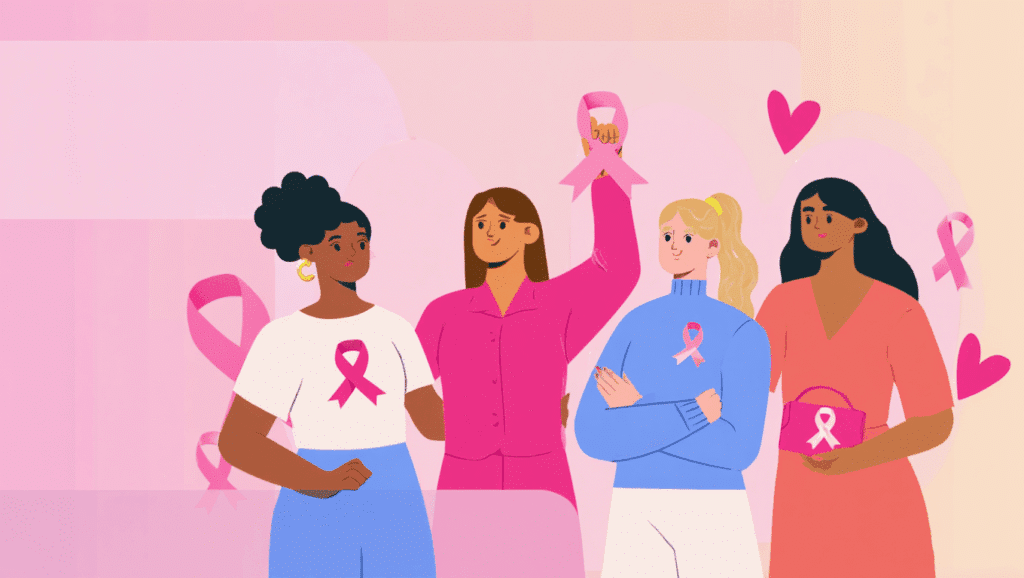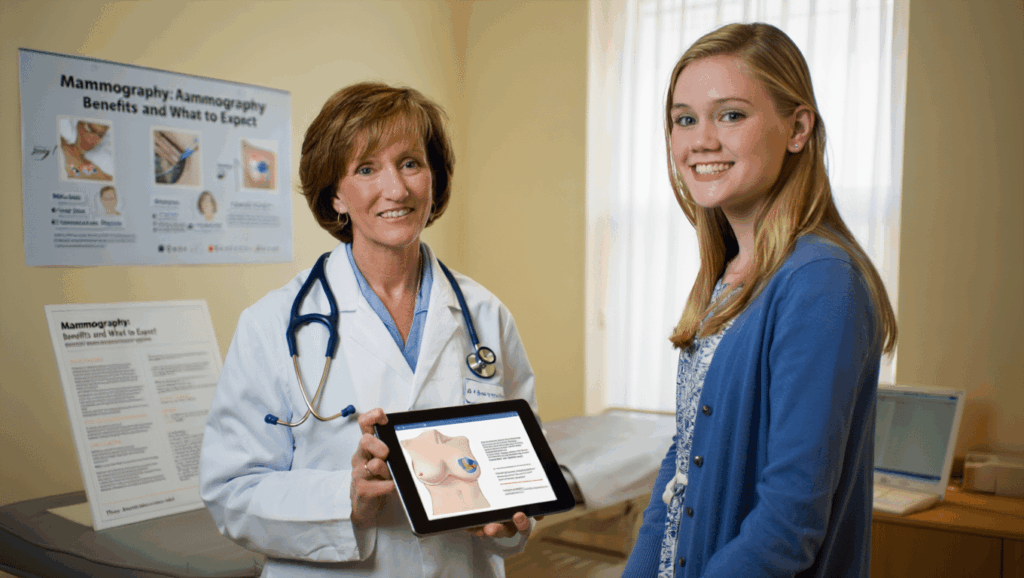L’endométriose est une maladie inflammatoire qui touche environ une femme sur 10.
Si elle est asymptomatique dans 1/3 des cas, elle altère la vie des autres femmes, parfois très lourdement.
La douleur pelvienne est le signe le plus évident de la maladie. Mais la symptomatologie, atypique selon l’organe atteint, peut retarder un diagnostic déjà long : 7 ans en moyenne.
Pour prendre le problème à bras le corps, il a fallu repenser l’accès au dépistage, sensibiliser et impliquer différents acteurs du soin, dont les sages-femmes.
Elles sont d’ailleurs souvent aux premières loges pour prendre soin de la santé des femmes.
Elles ont un rôle majeur à jouer dans le repérage précoce de cette maladie complexe.
À condition d’en reconnaître les signes, d’interroger les patientes sans préjugé et de savoir vers qui les orienter en cas de suspicion d’endométriose.
Alors quel est le rôle de la sage-femme dans le dépistage de l’endométriose et comment peut-elle accompagner ses patientes ?
C’est ce que nous verrons ci-après.
Comprendre l’endométriose et ses enjeux diagnostiques
Définition de l’endométriose :
L’endométriose est une maladie chronique, dans laquelle on retrouve du tissu semblable à l’endomètre en dehors de la cavité utérine.
Ces fragments de tissu peuvent être localisés à l’intérieur de la cavité abdominale (endométriose péritonéale), ou plus en profondeur (endométriose sous-péritonéale).
Les lésions d’endométriose sont de dimensions variables (de quelques dizaines de microns à plusieurs centimètres). Elles réagissent aux hormones, évoluent et se disséminent au rythme des cycles menstruels, provoquent des douleurs, des inflammations et parfois des adhérences.
On distingue plusieurs formes :
- Superficielle (péritonéale),
- Ovarienne (endométriomes),
- Profonde (infiltrant les organes pelviens ou digestifs).
La sévérité des symptômes n’est pas toujours proportionnelle à l’étendue des lésions. D’où l’importance d’un interrogatoire précis.
Les conséquences cliniques :
L’endométriose impacte lourdement le quotidien des femmes. En plus des douleurs cycliques et d’une fatigue chronique, elle peut entraîner une infertilité. L’endométriose peut d’ailleurs être dépistée au cours d’un bilan d’exploration de la fertilité.
Symptômes et signes cliniques évocateurs
Douleurs et symptômes à surveiller
Les principaux signes cliniques évocateurs de l’endométriose sont :
- Des dysménorrhées intenses, résistantes aux antalgiques.
- Des douleurs pelviennes chroniques en dehors des cycles.
- Une dyspareunie profonde.
- Des troubles digestifs ou urinaires liés au cycle.
- Une fatigue chronique.
- Des troubles de l’humeur.
Autres contextes révélateurs
D’autres signes sont révélateurs de la maladie :
- Infertilité inexpliquée ou bilan de fertilité anormal.
- Saignements anormaux (ménorragies, spotting).
- Antécédents familiaux d’endométriose.
Interrogatoire et examen clinique : le rôle clé de la sage-femme
Les délais moyens de diagnostic de l’endométriose sont souvent supérieurs à 7 ans : 7 ans d’errance médicale, de douleurs non soulagées, de doutes.
Mais depuis quelques années, on a mis des mots sur cette maladie, encore mal comprise. Et, différents professionnels de santé se sont engagés pour mieux accompagner les femmes qui en sont atteintes.
Parmi eux, on retrouve les sages-femmes dont le rôle est essentiel dans le repérage des signes de la maladie.
Leur proximité, leur empathie, leur implication dans la santé des femmes et la relation de confiance qu’elles nouent avec celles que l’on n’écoutait peu ou mal, font d’elles un atout majeur dans cet accompagnement particulier qui mêle dépistage, information, soutien mais aussi orientation vers un diagnostic spécialisé.
L’anamnèse ciblée
Le diagnostic d’endométriose est avant tout clinique : l’interrogatoire peut donc suffire à repérer les signaux. Il doit être complet, minutieux et orienté. Il permet d’identifier les symptômes, de les mettre en lien avec la survenue des menstruations, et d’orienter le diagnostic.
La sage-femme évalue :
- Le type de douleurs, leur localisation, leur intensité, leur fréquence, leur mode de survenue, leur durée, leur retentissement sur le quotidien et ce qui les soulage.
- Les troubles associés : douleurs pendant les rapports sexuels, troubles digestifs, urinaires, saignements anarchiques, douleurs à la marche…
- L’impact de la maladie sur la vie intime, scolaire ou professionnelle.
Examen gynécologique de 1er niveau
L’examen clinique est surtout gynécologique. Il complète l’interrogatoire, et permet d’orienter la prescription des examens d’imagerie.
L’examen gynécologique :
Il permet de rechercher les douleurs provoquées, les nodules, les masses et de préciser la nature ou l’anatomie des lésions.
Il peut être complété par :
Un examen abdominal :
Il a pour but de rechercher les douleurs abdominales à la palpation et d’éventuelles masses. En revanche, ces douleurs provoquées ne sont pas toujours spécifiques. Une sensibilité du cadre colique ou un abdomen chirurgical peuvent avoir une autre origine (occlusion, côlon irritable, colique néphrétique).
Un examen au spéculum :
Il permet de visualiser le col de l’utérus et de mettre en évidence certaines lésions comme un nodule d’endométriose profonde (rétraction fibreuse, lésion bourgeonnante, microkystes noirs).
Un toucher vaginal :
Il permet d’évaluer la sensibilité et d’identifier les lésions rétro-cervicales ou un utérus rétroversé. La palpation permet de distinguer une endométriose superficielle du cul de sac de Douglas, une endométriose profonde (nodules fibreux, lésion bourgeonnante), une adénomyose ou un endométriome ovarien.
Un toucher rectal :
Il est surtout proposé en cas de suspicion d’atteinte profonde ou de nodule rétro-vaginal.
Les examens d’imagerie à connaître
Certains types d’endométriose sont indétectables cliniquement. Des examens paracliniques complémentaires sont alors nécessaires pour confirmer le diagnostic, évaluer l’étendue des lésions (bilan d’extension), et proposer un traitement adapté.
Échographie pelvienne
L’imagerie de première intention est l’échographie pelvienne par voie endovaginale.
Elle permet de rechercher la présence de kystes ovariens endométriosiques (« kystes chocolat »), et parfois de détecter des lésions profondes qui nécessiteront une expertise.
Elle peut être complétée par une échographie abdominale, qui permet de déceler certaines complications de l’endométriose : sténoses urétérales avec dilatation pyélocalicielles, atrophie des reins, endométriose intra-abdominale étendue avec accumulation d’ascite.
IRM pelvienne
L’IRM abdomino-pelvienne est l’examen de seconde intention. Elle est prescrite par un médecin, en complément de l’échographie endovaginale, dès lors qu’une forme profonde est suspectée. La sage-femme peut en initier l’orientation.
Elle permet de visualiser les lésions d’endométriose intra-pelviennes et intra-abdominales (localisations digestives, urinaires, ligamentaires).
En revanche, elle ne détecte pas l’endométriose superficielle ou péritonéale (qui reste en surface du péritoine).
Autres examens selon contexte
D’autres examens complémentaires peuvent être indiqués en fonction de la symptomatologie. Parmi ceux-ci, le médecin peut demander :
- Une hystérosalpingographie ou hystéroscopie, pour rechercher d’éventuelles anomalies de l’utérus dans le cadre du bilan de fertilité (adhérences, perméabilité des trompes).
- Une échographie endorectale, un coloscanner ou une coloscopie virtuelle.
- Une cystoscopie, un uroscanner ou une uroIRM.
- Une IRM et/ou un scanner du diaphragme.
Le rôle de la coelioscopie dans le diagnostic
Cette chirurgie mini-invasive par laparoscopie permet de visualiser directement les lésions et confirme le diagnostic avec certitude.
La biopsie, réalisée au décours de la coelioscopie, confirme l’histologie des lésions et précise le stade des lésions selon le rAFS (revised American Fertility Society).
Néanmoins, elle n’est pratiquée que lorsque le doute diagnostique persiste ou pour traiter les lésions d’endométriose.
Focus sur le test salivaire
Créé en 2022, le test salivaire est considéré comme une avancée majeure dans le diagnostic de l’endométriose. L’Endotest de Ziwig est pris en charge par l’assurance maladie depuis février, pour une durée de 3 ans.
En revanche, la HAS n’a pas encore vraiment défini sa place dans le dépistage, par rapport aux examens d’imagerie.
Diagnostics différentiels à ne pas négliger
Les symptômes de l’endométriose pouvant être larges et atypiques, il est impératif d’établir le diagnostic différentiel pour écarter d’autres hypothèses cliniques telles que :
- L’adénomyose.
- Le syndrome du côlon irritable.
- Des infections pelviennes chroniques.
- Des fibromes.
- Des douleurs d’origine neurologique ou musculosquelettiques.
Quand et vers qui orienter ?
En cas de suspicion d’endométriose
Dès que la sage-femme suspecte l’endométriose chez l’une de ses patientes, elle l’oriente rapidement vers un gynécologue formé ou vers un centre expert.
Son rôle ne s’arrête pas là puisqu’elle collabore ensuite étroitement avec les différents intervenants : médecins généralistes, radiologues référents, psychologues, kinésithérapeutes, infirmiers…
Réseau et parcours de soins
Une fois le diagnostic posé et le traitement débuté, elle poursuit généralement l’accompagnement : soutien psycho-émotionnel, éducation thérapeutique, contraception ou projet de naissance.
Grâce au réseau qu’elle a constitué au fil de sa carrière, elle dispose de ressources fiables pour offrir un suivi de qualité et sécurisé.
Elle peut aussi vous fournir les coordonnées des centres experts avec lesquels elle est en lien. La liste est également disponible sur les sites de la HAS et endométriose.fr
Pourquoi le diagnostic est-il souvent tardif ?
Nous l’avons vu, à cause de sa symptomatologie particulière, sortant parfois de la sphère gynécologique, l’endométriose est difficile à diagnostiquer, et les femmes peuvent souffrir des années sans être soulagées.
En cause également, la banalisation et le tabou qui persistent encore autour des douleurs menstruelles. Dans certains parcours de soin, les femmes sont encore confrontées à la stigmatisation ou à une minimisation de leur douleur, surtout quand elles touchent aux cycles.
Le manque de formation spécifique à l’endométriose et la méconnaissance des recommandations de la HAS concernant le recours à l’imagerie experte influent également sur le retard de diagnostic.
Enfin, il existe encore des disparités régionales dans l’accès au diagnostic spécialisé, malgré les efforts de structuration des filières. Les sages-femmes sont parfois les seules interlocutrices disponibles, d’où l’importance de renforcer leur formation et les partenariats.
Ce que disent les recommandations officielles
Dans ses recommandations de 2017 sur le parcours de soins, le repérage clinique, l’orientation et le recours à l’imagerie, la HAS encourage tous les professionnels de première ligne, y compris les sages-femmes, à s’impliquer dans le repérage précoce de l’endométriose.
Par ailleurs, le Plan national Endométriose (2022-2025) encourage la formation des professionnels de 1er recours à l’endométriose (e-formation : MOOC endométriose).
Et, les réseaux spécialisés comme EndoFrance ou RESENDO appuient l’implication active des sages-femmes.
Le rôle de la sage-femme face à une suspicion d’endométriose
Parce qu’elles sont accessibles et à l’écoute, les sages-femmes sont souvent les premières à qui les femmes confient leurs douleurs.
Leur intervention permet de déclencher une orientation rapide vers un spécialiste, d’éviter l’errance médicale, et d’améliorer la qualité de vie des patientes.
Lors des consultations gynécologiques, la sage-femme :
- Repère les signes d’alerte.
- Interroge sans banaliser.
- Écoute activement.
- Prescrit (ou recommande) une échographie pelvienne.
- Peut prescrire un antalgique de palier 1.
- Oriente vers un médecin spécialiste ou un centre expert pour confirmer le diagnostic.
- Informe sa patiente sur la pathologie et les options diagnostiques.
- L’accompagne dans l’attente du diagnostic (douleur, contraception, soutien émotionnel).
En revanche, elle ne peut pas :
– Prescrire une IRM ou des examens spécialisés lourds.
– Poser un diagnostic définitif d’endométriose.
– Gérer les formes sévères ou extra-pelviennes d’endométriose.
– Prescrire des antalgiques de palier 2 ou 3.
– Proposer une prise en charge chirurgicale.
Mais, pour être pleinement efficace et proposer un accompagnement sécurisé, elle doit compléter sa formation initiale, par des formations continues, qui incluent les éléments de diagnostic clinique, les examens utiles, et le parcours de soins.
Ces formations sont notamment proposées par les filières régionales dédiées à l’endométriose (Endo-IDF, EndAURA, EndoBFC, EndoBreizh, EndoNouvelle-Aquitaine…).
Pour conclure…
Nous l’avons vu, la sage-femme est souvent en première ligne pour repérer les signaux évocateurs de l’endométriose.
En écoutant attentivement ses patientes, en les interrogeant avec bienveillance, en les orientant sans attendre, elle peut faire la différence entre des années d’errance médicale et de douleurs, et l’espoir de revivre enfin normalement.
Mais repérer l’endométriose, ce n’est pas seulement poser un diagnostic. C’est aussi redonner du sens, du pouvoir et de la dignité à une parole trop longtemps ignorée.
Pour cela, la sage-femme doit se former pour actualiser ses connaissances, savoir reconnaître les symptômes, prescrire le bon examen et savoir quand orienter et référer.
Avez-vous déjà travaillé en collaboration avec une sage-femme ?
Que pensez-vous de leur rôle dans la prise en charge de l’endométriose ?
Source :