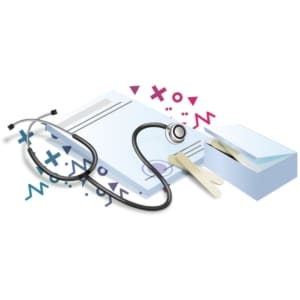Quand on pense à la relation soignant-soigné, des notions comme l’écoute, la bienveillance, le respect et la confiance nous viennent spontanément à l’esprit.
Pourtant, si elle a longtemps été perçue comme une évidence, la réalité rappelle parfois à quel point elle est fragile : agressions de soignants, situations de maltraitance…
Cette fragilité est essentiellement due aux conditions de travail, aux contraintes des services, et à l’essor des nouvelles technologies qui ont pris le pas sur le contact humain.
Résultat, le patient se sent livré à lui-même, les réclamations s’accumulent, la qualité des soins est remise en question, et les soins s’exercent dans un climat de tension, d’incompréhension, parfois de défiance ou de violence.
Heureusement, il suffit parfois de peu pour renouer le dialogue, adapter son positionnement, et rétablir une relation de confiance avec des patients souvent incompris, que le personnel débordé, n’a plus vraiment le temps de regarder.
Alors quels sont les principes fondamentaux de cette relation, ses enjeux, les freins rencontrés, et les recommandations pour l’améliorer ?
C’est ce que nous verrons ensemble aujourd’hui.
Qu’est-ce que la relation patient-soignant ?

Une hospitalisation, l’annonce d’un diagnostic, une maladie chronique sont autant de situations qui bouleversent la vie d’un patient — qui perd ses repères, son statut social, et parfois son autonomie.
Votre rôle est alors déterminant : accueil, écoute, réassurance, explication, accompagnement.
La relation patient-soignant désigne l’interaction entre un professionnel de santé (médecin, infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute…) et un patient.
Elle est fondée sur la confiance, le respect et la communication.
Pourquoi est-elle essentielle ?
Bien plus qu’un simple acte technique, c’est l’un des piliers de l’alliance thérapeutique.
Elle influence directement l’efficacité et la qualité des soins, l’adhésion aux traitements, mais aussi le bien-être et la satisfaction du patient.
Elle conditionne aussi la motivation et la satisfaction professionnelle du soignant.
Les piliers d’une relation thérapeutique de qualité
Confiance, respect et autonomie
Sans confiance, il n’y a pas de soins efficaces. Elle est indispensable à la communication thérapeutique, et permet au patient d’exprimer plus librement ses inquiétudes.
Le respect, quant à lui, suppose de reconnaître la personne dans son intégrité : ses choix, ses besoins, ses valeurs, son intimité, même quand ils sont différents de ceux attendus. Un patient respecté est un patient qui accepte plus volontiers le traitement, car il ne se sent pas réduit à une pathologie.
Enfin, l’autonomie se traduit notamment par le consentement éclairé. C’est transmettre des informations claires, compréhensibles et adaptées, répondre aux questions, pour que le patient puisse participer aux décisions.
Le soignant ne prescrit plus seulement : il coconstruit le projet de soins avec son patient.
Écoute active et empathie
L’écoute active ne se limite pas aux mots prononcés. Elle suppose de percevoir les émotions, les préoccupations implicites : les silences, les gestes, les hésitations dans la voix. Reformuler, poser des questions ouvertes, repérer un regard inquiet ou une crispation sont autant d’indices qui permettent de comprendre ce que le patient n’ose pas toujours dire mais que son corps trahit.
L’empathie va plus loin. Elle consiste à comprendre le vécu du patient sans jugement, dans une posture de bienveillance. Elle humanise la prise en charge, améliore la relation de confiance, et réduit le stress et l’anxiété, important pour un bon rétablissement.
Mais cette empathie doit s’accompagner d’une distance thérapeutique adaptée : trop de proximité fragilise le soignant, trop de distance déshumanise la relation.
La bienveillance, ou bienfaisance, est inscrite dans l’éthique médicale et infirmière. Elle engage à agir dans l’intérêt du patient : qualité des soins, réduction des risques, accompagnement global qui prend en compte les dimensions physiques, psychologiques et sociales.
Confidentialité
Le respect de la confidentialité est un principe éthique et déontologique fondamental dans la relation soignant-soigné. Elle garantit au patient qu’il peut se confier sans crainte de divulgation. Toute atteinte à ce principe fragilise la relation et peut rompre la confiance, parfois définitivement.
À l’heure des dossiers partagés et des téléconsultations, la vigilance doit être renforcée : protéger les données personnelles, limiter l’accès aux seules personnes autorisées, respecter le secret médical dans toutes les situations. C’est l’un des enjeux éthiques de cette bascule vers la e-santé.
Les composantes clés de la communication
La communication est le fil conducteur de la relation soignant-soigné. Elle conditionne la qualité des soins, mais aussi la sécurité des patients et la fluidité du parcours de soins.
Elle commence par la simple relation de civilité, qui commence bien avant l’acte technique : saluer, se présenter. Ce premier contact influence fortement la perception du patient et prépare le terrain d’une relation constructive.
Le reste se fait grâce à une communication claire et adaptée, qui passe par des mots simples, un ton rassurant, des explications illustrées ou imagées, et des supports écrits compréhensibles.
| Composantes | Bonnes pratiques |
| Communication verbale | Langage clair, adaptation au niveau de compréhension, reformulation, questions ouvertes. |
| Communication non-verbale | Posture ouverte, contact visuel, expressions faciales cohérentes, toucher professionnel si approprié. |
| Communication écrite et numérique | Rédaction de documents compréhensibles, clarté dans les consignes, maîtrise des échanges numériques (téléconsultation, email, SMS). |
Les bénéfices d’une relation de qualité
Une relation thérapeutique solide permet une :
· Meilleure observance des traitements prescrits
· Meilleure implication du patient dans son programme de soins
· Réduction de l’anxiété, de la douleur perçue, et du stress
· Diminution des malentendus et des conflits
· Amélioration globale de la qualité de vie du patient
· Valorisation du rôle du soignant et prévention de l’épuisement professionnel.
Freins et obstacles à surmonter
Contraintes organisationnelles et charge émotionnelle
Manque de temps, surcharge de travail, plannings saturés : les soignants doivent souvent enchaîner les soins et privilégier l’efficacité et le rendement au détriment de l’échange humain. Ce manque de disponibilité, bien que compréhensible, laisse parfois les patients avec un sentiment d’abandon.
La fatigue empathique, la démotivation et le burn-out menacent également la qualité relationnelle, parce qu’un soignant épuisé ne peut pas maintenir la même disponibilité émotionnelle.
Barrières culturelles ou linguistiques
Les patients viennent d’horizons variés ou ont des attentes différentes.
Certains sont hyperconnectés, d’autres attachés au contact humain, d’autres encore ont des repères culturels ou linguistiques éloignés. Sans interprètes ni formation à la diversité culturelle, la compréhension mutuelle peut devenir difficile. Et dans un cadre standardisé comme l’est l’hôpital, il est souvent difficile de mettre en place ces adaptations.
Gestion des émotions difficiles
La colère, la peur, le déni font partie des réactions fréquentes des patients. Pour le soignant, l’enjeu est d’accueillir ces émotions sans rupture relationnelle.
La posture doit rester calme, professionnelle et empathique.
Par ailleurs, les outils numériques, comme les téléconsultations ou les dossiers électroniques, transforment la relation soignant-soigné. Mal intégrés, ils peuvent nuire aux interactions et renforcer la distance émotionnelle, alors que bien utilisés, ils peuvent au contraire libérer du temps pour l’échange.
Bonnes pratiques relationnelles à mettre en œuvre
Principes fondamentaux à appliquer au quotidien
Les principes de base à intégrer sont :
- Se présenter clairement et instaurer une relation de confiance dès le premier contact
- Écouter activement, reformuler les propos du patient, poser des questions ouvertes
- Clarifier les attentes, respecter les préférences du patient
- Adapter son langage et sa posture à chaque patient.
Synthèse – Check-list relationnelle
| Check-list relationnelle : – Créer un climat de confiance dès le premier contact. – Maintenir une posture empathique et respectueuse. – S’assurer de la compréhension du patient. – Favoriser le dialogue et l’implication du patient. – Respecter les choix et le rythme du patient. |
Au-delà de ces principes, l’usage d’outils concrets peut aider à améliorer la relation soignant-soigné : enquêtes d’expérience patient, plateformes collaboratives, partenariats patients-soignants.
Ces démarches favorisent la co-construction du parcours de soins et renforcent la confiance mutuelle.
Adapter la relation à chaque situation
Enfin, un point à ne pas négliger, c’est de s’adapter aux patients et à leurs capacités.
Personnes âgées
Chez la personne âgée, souvent attachée au contact humain, il faut valoriser la présence physique, le contact rassurant, tout en prenant en compte les déficits sensoriels et cognitifs, et en adaptant le rythme de l’échange.
Enfants et adolescents
Chez les enfants, on utilise un langage simple et imagé, on crée un environnement rassurant et ludique, et on implique les parents dans le dialogue thérapeutique.
Patients non communicants ou en fin de vie
Chez les patients non communicants ou en fin de vie, on est attentif aux signes corporels et à l’environnement familial. On maintient une présence bienveillante et silencieuse et développe une communication non verbale adaptée.
Patients agressifs ou méfiants
Chez les patients agressifs, on identifie d’abord les émotions sous-jacentes (peur, sentiment d’injustice). Ensuite, on applique les techniques de désamorçage verbal, et on évite l’escalade en gardant une posture calme et une écoute bienveillante.
| Dans un centre d’imagerie médicale, une femme souffrant d’agoraphobie a déclenché une crise de panique devant la salle d’attente bondée. Ses signes — voix mécanique, agitation, piétinement — ont été perçus comme de l’agressivité. L’assistante, puis le radiologue, ont menacé d’annuler l’examen sans lui laisser la possibilité de s’exprimer. L’incident a été classé comme « événement indésirable », le service qualité ayant estimé qu’il appartenait à la patiente d’annoncer son handicap en amont du rendez-vous. Cet épisode montre combien le défaut d’écoute et de formation aux troubles psychiques invisibles peut transformer une vulnérabilité en maltraitance. |
Former les soignants à la relation et à la communication
Formation initiale et continue
Si les formations de base (IFSI, facultés de médecine) posent les fondations de la relation soignant-soigné, la formation continue, et notamment le DPC, est un outil de choix pour améliorer les bonnes pratiques. Le programme des actions de formation spécifique doit inclure :
- La communication interpersonnelle
- La gestion des émotions
- La médiation culturelle.
Outils à privilégier
Les outils à privilégier sont les simulations et mises en situation, l’analyse de pratiques en équipe, les ateliers de développement de l’intelligence émotionnelle, et les programmes de gestion du stress et de prévention du burn-out.
Pour conclure…
La relation patient-soignant est l’essence même du soin. Elle repose sur des compétences humaines à intégrer au quotidien : écoute, respect, empathie, clarté des informations et adaptabilité.
Elle conditionne l’efficacité thérapeutique, la qualité des soins, l’expérience des patients et la santé mentale des soignants.
Renforcer ce lien, c’est investir dans une prise en charge à la fois humaine, éthique et performante.
Cela passe par la formation, l’organisation des soins, et la reconnaissance pleine et entière de la dimension relationnelle du soin comme un acte à part entière.
Ces compétences relationnelles sont indispensables et doivent être entretenues tout au long de la carrière : elles sont le socle d’un soin humain et efficace.
Avez-vous déjà rencontré des difficultés relationnelles avec vos patients ?
Quelles sont vos astuces pour désamorcer le conflit ?
Enfin, si vous avez trouvé cet article utile, pensez à la partager autour de vous.
Source :
HAS : démarche centrée sur le patient
HAS : boîte à outils