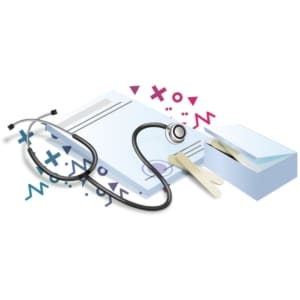Et si la santé se jouait entre deux repas ? C’est en tout cas la promesse du jeûne intermittent, une pratique qui séduit de plus en plus, que ce soit pour perdre du poids, gagner en énergie, améliorer ses performances, ou pour vivre plus longtemps et mieux.
On connaissait déjà les bienfaits de l’alimentation équilibrée sur notre santé métabolique, surtout quand elle est associée à une reprise de l’activité physique, et une amélioration globale de l’hygiène de vie.
Mais, on parlait moins des stratégies de restriction temporelle comme l’alimentation restreinte dans le temps (TFR : Time Restricted-Fasting) ou la restriction alimentaire énergétique (IER : Intermittent Energy Restriction).
Et si la notion de jeûne est connue depuis longtemps, ce sont les réseaux sociaux et l’engouement pour les médecines naturelles, qui ont remis cette approche ancestrale au goût du jour, et propulsé le jeûne intermittent —encore appelé Fasting— dans nos vies.
En revanche, si les bienfaits sur la santé peuvent être intéressants, le jeûne intermittent peut aussi entraîner des risques, notamment s’il est mal conduit.
Parce que derrière cette pratique réputée sûre et saine, il y a aussi des effets indésirables, qui peuvent être graves et nécessiter un suivi médical.
Jeûner se prépare et la méthode choisie doit s’adapter au profil du patient.
Alors, comment s’y retrouver parmi les multiples formats proposés – 16/8, 18/6, OMAD ou 5:2 – et surtout, quels horaires choisir pour en tirer réellement des bénéfices ? C’est ce que nous verrons ensemble dans cet article.

Les bases du jeûne intermittent
Mécanisme
Le jeûne n’a rien de nouveau. Depuis des millénaires, il accompagne les pratiques spirituelles et religieuses. Ce qui change aujourd’hui, c’est l’intérêt scientifique qu’il suscite, et la place qu’il prend dans la prévention santé.
Le principe est simple : alterner des périodes de prises alimentaires avec des périodes de repos digestif, généralement de 12 à 24 heures. Pendant la phase de jeûne, seuls l’eau, le café noir et les tisanes sans sucre sont autorisés. Contrairement aux régimes hypocaloriques classiques, il ne s’agit pas de compter les calories, mais de composer avec le temps.
Privé d’apports, l’organisme active ses ressources physiologiques pour se nettoyer et récupérer : meilleure régulation hormonale (insuline, leptine, ghréline), recours accru aux graisses comme carburant, et stimulation de l’autophagie, ce mécanisme de “nettoyage cellulaire” où les cellules recyclent leurs composants abîmés et protège du vieillissement.
Mais si le jeûne intermittent fonctionne chez les uns, il peut être inefficace voire dangereux pour les autres. Tous les jeûnes n’optimisent pas le métabolisme, ne font pas perdre de poids, et n’améliorent pas forcément les marqueurs de santé (glycémie, sensibilité à l’insuline, inflammation), surtout s’il est mal choisi.
Alors, avant de se lancer dans cette pratique considérée à tort comme sans danger, il est impératif de consulter un médecin ou un professionnel formé, pour un accompagnement personnalisé et sûr.
Différence avec les régimes traditionnels
Le jeûne intermittent se distingue de la restriction calorique par son approche plus physiologique et progressive : il respecte le rythme circadien naturel, encourage un régime alimentaire plus qualitatif, et limite la frustration. Beaucoup de patients rapportent une meilleure stabilité de leur alimentation au quotidien, sans avoir l’impression de « se priver ».
Les bénéfices potentiels :
- Perte de poids : les résultats sont variables, allant de 0,8 à 13 % du poids corporel selon les études, et comparables à une restriction calorique classique (Welton 2020, Zhang 2022).
- Santé cardiovasculaire : baisse du cholestérol et des triglycérides, surtout grâce à la perte de masse grasse.
- Diabète : amélioration de la glycémie et de la sensibilité à l’insuline, surtout quand la fenêtre alimentaire est placée tôt dans la journée (Jamshed 2019).
- Sport : chez les pratiquants de musculation, le protocole 16/8 n’altère pas la masse musculaire, à condition que les apports protéiques soient suffisants (Moro 2016).
- Vieillissement : actions protectrices sur certaines maladies neurodégénératives —Alzheimer, Parkinson— grâce à l’autophagie (Institut Pasteur, Sinclair Lifespan).
| Zoom sur deux études montrant les bénéfices du jeûne : Sutton et al. (Cell Metabolism, 2018) → Étude clinique sur des hommes prédiabétiques. → Repas limités à une fenêtre de 6 h (avant 15 h). Résultats : meilleure sensibilité à l’insuline, baisse de la tension artérielle, réduction du stress oxydatif… sans perte de poids significative. Tinsley & La Bounty (Nutrition Reviews, 2015) → Revue des études humaines sur différents types de jeûne intermittent. → Jeûne alterné ou prolongé : perte de poids (3 à 9 %), de masse grasse et amélioration des indicateurs lipidiques. Attention : pour le jeûne à restriction temporelle, les données restaient trop limitées à l’époque pour être définitives. En conclusion : certains bénéfices ne reposent pas seulement sur la perte de poids. Ils soulignent aussi la nécessité d’adapter le protocole au profil du patient et de rester prudent face aux formes extrêmes. |
Formats et horaires types : que choisir selon l’objectif ?
| Objectifs/Profils : | Format recommandé : | Exemple d’horaire : | Public cible / remarques : |
| Perte de poids : | 16/8 | 12-20h | Accessible aux débutants. Facile à intégrer socialement. |
| Santé métabolique : | 16/8 ou 18/6 | 8-16h | Favorise la sensibilité à l’insuline. |
| Performances cognitives : | 18/6 | 9-15h | Optimise la vigilance et la concentration. |
| Mode bureau : | 16/8 | 12-20h | Compatible avec les horaires de travail classiques. |
| Flexibilité hebdomadaire : | 5:2 | 2 jours à 500 à 600 Kcal. | Le jeûne alterné est intéressant pour débuter sans bouleverser le quotidien. Des variantes existent : 6:1 ou 4:3. |
| Mode extrême (avancé) : | OMAD ou One Meal A Day : 23/1. | 19h-20h | Réservé aux profils expérimentés, sous suivi médical rigoureux. |
Comment choisir ses horaires de jeûne ?
En fonction du rythme circadien
Notre métabolisme fluctue tout au long de la journée. Il suit les lois de l’horloge biologique.
Par ailleurs, l’organisme dépense davantage d’énergie en matinée et en milieu de journée, les apports alimentaires sont donc mieux métabolisés et la digestion, plus efficace. Au contraire, le soir, la température diminue, le corps se prépare au repos, et le métabolisme ralentit. Manger tard augmente donc le risque de stockage et perturbe le sommeil (température métabolique).
C’est une des raisons pour lesquelles les études montrent qu’un jeûne avec fenêtre matinale (8h-16h) a plus d’impact sur la régulation glycémique et de l’insuline qu’un jeûne tardif (13h-21h), qui reste plus pratique socialement mais moins optimal physiologiquement.
En fonction des objectifs
Les horaires de la fenêtre alimentaire sont importants et ne seront pas les mêmes selon les objectifs :
- Perte de poids : format 16/8 ou 18/6 en fin de journée, avec déficit calorique modéré.
- Énergie mentale : fenêtre d’alimentation plus précoce (8h00-16h00).
- Activité physique : caler l’alimentation autour des entraînements (ex : 10h-18h si entraînement à midi).
L’objectif est de trouver un équilibre durable entre bénéfices physiologiques, besoins nutritionnels, rythme de vie et tolérance personnelle.
Il est déconseillé de restreindre la fenêtre alimentaire en-dessous de 6h sans avis médical ou accompagnement spécialisé.
| Selon l’Anses (2024), le timing des repas influence directement le métabolisme : – Un dîner tardif (moins de 2 heures avant le coucher) est associé à un risque accru de surpoids et de troubles métaboliques. – Un jeûne nocturne prolongé est bénéfique s’il inclut un petit-déjeuner le lendemain —sauter ce repas augmente le risque cardiométabolique. – Répartir davantage d’apports énergétiques le matin plutôt que le soir améliore la régulation du poids et de la glycémie. Le choix de la fenêtre horaire est déterminant. Une fenêtre alignée sur le rythme circadien favorise les bénéfices métaboliques, tandis qu’un jeûne tardif peut les réduire, voire les inverser. |
Conseils pratiques pour bien vivre son jeûne
Alimentation et hydratation
- Boire régulièrement : eau, infusions, café sans sucre.
- Privilégier des repas riches en fibres, protéines et bonnes graisses (poissons gras, œufs, légumes, oléagineux).
- Limiter les sucres rapides et les aliments ultra-transformés qui perturbent le métabolisme.
- Attention à l’hyperphagie en période de reprise alimentaire.
Écoute des signaux corporels
Chaque patient réagit différemment à la privation prolongée de nourriture. Il faut donc surveiller l’apparition d’une fatigue excessive (généralement liée à la fonte musculaire), difficulté d’endormissement, irritabilité, baisse de concentration.
Et pour réussir son jeûne, il faut :
- Adapter la durée ou les horaires, notamment si les effets secondaires persistent.
- Organiser les fenêtres de jeûne.
- Planifier les menus.
- Anticiper les événements susceptibles de perturber la routine instaurée.
- Utiliser des applications de suivi dédiées.
Suivi médical
En revanche, pour ceux qui vivent avec une maladie chronique ou qui suivent un traitement strict, un accompagnement médical rigoureux est impératif.
C’est le cas des diabétiques de type 2 —même si les bénéfices sur la glycémie et la résistance à l’insuline sont démontrés par certaines études.
Mais aussi des patients avec des troubles cardiométaboliques, cardiovasculaires ou hormonaux. Les risques de dénutrition et de déshydratation seront également régulièrement contrôlés.
Il n’existe pas de structures médicalisées dédiées au jeûne. Il faut alors se tourner vers le médecin ou un professionnel de la nutrition pour un suivi de qualité.
Précautions et contre-indications
Populations à risque
Le jeûne intermittent est contre-indiqué chez :
- Les femmes enceintes ou allaitantes : apporter régulièrement les nutriments essentiels est nécessaire au développement du fœtus et à la production de lait.
- Les enfants et adolescents, qui sont en pleine croissance ou développement pubertaire.
- Les patients atteints de diabète de type 1 (risque d’hypoglycémies sévères).
- Les personnes ayant des antécédents de troubles du comportement alimentaire ou ayant un IMC inférieur à 18,5.
- Les personnes âgées (risques de dénutrition, déshydratation, aggravation des pathologies).
Effets indésirables possibles
Les principaux effets indésirables rencontrés sont les vertiges, maux de tête, hypoglycémie légère, troubles de l’humeur.
Ils sont transitoires, et régressent normalement de manière progressive, après une phase d’adaptation de quelques jours à deux semaines.
S’ils persistent, le protocole doit être ajusté voire stoppé.
Un jeûne strict et prolongé peut provoquer des anémies par carence en fer, des inflammations et fibroses hépatiques, une dégradation du capital osseux voire des troubles du rythme cardiaque.
Ce qu’il faut retenir
| Le jeûne intermittent est un outil flexible et efficace, mais qui doit être individualisé. L’horaire idéal dépend du rythme de vie, des objectifs et de la tolérance personnelle. La méthode 16/8 reste la plus simple, la plus facile à intégrer et donc la plus utilisée. Le respect du rythme circadien maximise les bénéfices métaboliques. Le suivi médical est essentiel, surtout pour les profils à risque. |
Pour conclure…
Le jeûne intermittent n’est pas un énième régime ou une nouvelle recette antiâge miracle, mais bien un outil nutritionnel puissant quand il est correctement utilisé et adapté au contexte de chacun.
Il peut améliorer la santé métabolique, favoriser la combustion des graisses et la perte de poids ou soutenir les performances cognitives.
Mais le choix des horaires est stratégique et doit être minutieusement étudié : il doit tenir compte du rythme biologique, des objectifs fixés, mais aussi du quotidien du patient.
Les professionnels de santé ont un rôle clé à jouer dans le repérage des patients à risque et leur accompagnement au quotidien. Mener cette démarche avec pédagogie et vigilance, c’est maximiser ses bénéfices tout en minimisant les risques. Parce qu’il n’existe pas un horaire universel, mais un horaire personnalisé, à ajuster au cas par cas.
Et vous, comment accompagnez-vous vos patients qui souhaitent tester le jeûne intermittent ?
Pour terminer, si cet article vous a plu, n’hésitez pas à le partager autour de vous.
Sources :
Anses : https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2019SA0001Ra.pdf
Observatoire de la prévention (Dr M Juneau, Institut de cardiologie de Montréal).
Livres :
« Le guide complet du jeûne », Dr J Fung
« Jeûne intermittent : approche raisonnée », Christophe Carrio
« Je débute mon jeûne intermittent », Olivia Charlet et Alix Lefief-Delcourt
Études :
Sutton EF et al., Early Time-Restricted Feeding Improves Insulin Sensitivity (Cell Metabolism, 2018).
Tinsley GM & La Bounty PM, Effects of Intermittent Fasting on Body Composition and Clinical Health Markers in Humans (Nutrition Reviews, 2015).