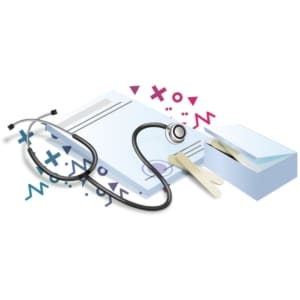Mauvaise haleine, toux, crachats, envolée des prix du paquet, interdiction de fumer dans les lieux publics, panique quand il ne reste qu’une cigarette dans le paquet, complications cardiovasculaires, maladies respiratoires, cancers…le tabac a tout pour déplaire, et pourtant, il fait toujours autant d’adeptes, puisque près de 15 millions de français continuent de fumer, occasionnellement ou quotidiennement, malgré les campagnes de sensibilisation.
La bonne nouvelle est que 60% d’entre eux déclarent vouloir arrêter de fumer.
Mais, même si l’on sait que le tabac est impliqué dans 75 000 décès évitables chaque année, se passer complètement et définitivement de la cigarette n’est pas de tout repos.
En revanche, un accompagnement pluridisciplinaire structuré et bienveillant peut aider le fumeur à se débarrasser de son addiction et à reprendre la main sur sa vie, loin du tabac.
C’est d’autant plus important qu’en arrêtant de fumer, on ressent déjà les bénéfices sur sa santé dès les premiers jours, qu’à moyen terme les complications cardiovasculaires et pulmonaires diminuent fortement, et que sur le long terme, les risques rejoignent quasiment ceux des non-fumeurs, même quand on a beaucoup fumé.
Pour les soignants, l’accompagnement au sevrage tabagique fait partie intégrante de la prévention et du suivi des patients, qu’ils soient des gros fumeurs ou des fumeurs occasionnels, déjà malades du tabac —ou sans lien avec lui—, ou pas.
Alors concrètement comment pouvez-vous accompagner les fumeurs dans leur sevrage ? Quelles sont les aides actuelles ? Et comment sont-elles prises en charge par l’assurance maladie ? C’est ce que nous verrons ensemble dans cet article.

Comprendre l’addiction tabagique
Nature de l’addiction au tabac
Tout d’abord, l’addiction concerne tous les usages du tabac quelle qu’en soit la forme : fumé (cigarette, cigare, tabac à rouler, pipe, narguilé), prisé, mâché (snus), associé ou non à d’autres substances (joint).
L’addiction repose sur trois dimensions complémentaires.
La dépendance physique : la nicotine inhalée atteint le cerveau en quelques secondes et stimule les récepteurs nicotiniques, provoquant une libération de dopamine dans le circuit de la récompense.
Rapidement, le cerveau s’habitue et le fumeur doit maintenir ou augmenter sa consommation pour éviter le manque (irritabilité, anxiété, difficultés de concentration, craving). La tolérance s’installe, et renforce le cercle vicieux.
La dépendance psychologique s’appuie sur l’effet anxiolytique et stimulant de la cigarette, utilisée comme un outil de régulation émotionnelle (stress, ennui, concentration, convivialité). Le fumeur développe la croyance qu’il ne pourra pas gérer ses émotions sans tabac.
Enfin, la dépendance comportementale se nourrit des rituels quotidiens : cigarette du matin, celle du café ou des pauses sociales. Ces conditionnements environnementaux renforcent l’addiction, et ces ancrages expliquent la force du craving —ce désir compulsif d’allumer une cigarette (associé à une perte de contrôle de sa consommation) — et la difficulté de maintenir l’abstinence et les rechutes.
Reconnaître le manque physiologique, les signaux conditionnés, et apprendre à les gérer est essentiel pour le maintien de l’abstinence.
Évaluation de la dépendance au tabac
Le test de Fagerström, qui tient compte notamment du délai avant la première cigarette le matin, reste la référence pour évaluer la dépendance physique à la nicotine.
Mais l’évaluation doit aussi inclure la dimension psychologique et motivationnelle : entretien motivationnel, repérage du stade de changement (pré-contemplation, préparation, action, maintien). Cette évaluation globale permet d’adapter les stratégies d’accompagnement.
Le rôle des professionnels de santé dans le sevrage tabagique
Les acteurs impliqués dans l’accompagnement
Pour accompagner les fumeurs dans leur démarche de sevrage, différents professionnels peuvent être sollicités, indépendamment ou en concertation.
Le médecin généraliste, qui joue un rôle central dans le repérage précoce des risques, la prescription de substituts nicotiniques ou médicaments de soutien au sevrage, qui réalise des entretiens motivationnels, et assure le suivi médical.
Le pharmacien, qui est en lien direct et régulier avec le patient, délivre les substituts, apporte un suivi de proximité, un soutien dans les moments difficiles, des conseils et ajustements pratiques.
Les infirmiers, kinésithérapeutes et sages-femmes, qui sont au plus près du quotidien des patients, ont également une place centrale dans le soutien, le suivi des symptômes et l’encouragement.
Enfin, le tabacologue peut intervenir pour les cas complexes ou les échecs répétés, en proposant une prise en charge spécialisée.
Quel que soit le soignant consulté, son rôle est d’écouter, motiver et accompagner. Même un entretien bref peut déclencher un changement. Il est essentiel de repérer la motivation, d’expliquer les mécanismes de dépendance, de proposer un plan personnalisé et d’assurer un suivi rapproché.
Travail pluridisciplinaire
Le sevrage tabagique est rarement un voyage en solitaire. La réussite repose sur une approche coordonnée entre différents professionnels de santé qui interviennent à différents niveaux ou différentes étapes du parcours de sevrage, mais toujours en complémentarité et en coordination pour une approche à la fois globale et personnalisée.
D’autres structures spécialisées ou ressources telles que les réseaux régionaux, Tabac info service et les programmes d’aide à l’arrêt du tabac permettent de renforcer l’efficacité et la continuité du suivi.
Les traitements disponibles pour le sevrage
Substituts nicotiniques
Patchs, gommes, pastilles, inhaleurs, sprays buccaux : la palette des substituts nicotiniques (TNS) offre une belle marge de manœuvre pour contrôler les symptômes de manque.
Le choix de la forme et du dosage dépend du profil du patient, de son niveau de dépendance et de ses préférences (1 cigarette = 1 mg de nicotine).
La HAS préconise de combiner des formes orales, à effet immédiat, à des patchs, à libération prolongée.
La posologie de TNS peut être réajustée en fonction de l’existence de symptômes, dont les plus courants sont : irritabilité, anxiété, troubles du sommeil, difficultés de concentration, humeur dépressive passagère, augmentation de l’appétit et craving.
En général, ils atteignent leur paroxysme dans les 2-3 premiers jours puis s’atténuent progressivement en 2-4 semaines. Votre rôle est de rassurer le patient et d’expliquer que ces réactions sont normales.
Les TNS sont le traitement de première intention dans le sevrage tabagique. Ils peuvent être proposés aux femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse, en cas d’échec de la prise en charge non médicamenteuse.
Depuis 2018, ces traitements sont pris en charge par l’Assurance Maladie s’ils sont prescrits par un professionnel de santé, avec complément possible par les mutuelles.
Médicaments non nicotiniques
Deux molécules sont reconnues : le bupropion (Zyban) et la varénicline (Champix). Elles agissent sur les récepteurs nicotiniques ou la régulation de la dopamine. Leur prescription nécessite une consultation tabacologique et une évaluation médicale approfondie en raison des contre-indications et effets indésirables possibles (troubles de l’humeur, insomnie).
Elles peuvent être utiles en seconde intention —après échecs des TNS et des approches non médicamenteuses, ou pour les patients très dépendants (score au test de Fagerström ≥ 7).
La varénicline est délivrée sur prescription médicale, Ses modalités de remboursement sont celles de droit commun : soit à hauteur de 65% par l’assurance maladie, avec complément par la mutuelle. Elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes, et déconseillée chez les femmes allaitantes.
Méthodes complémentaires
Hypnose, acupuncture, relaxation : leur efficacité est variable selon les études, mais elles peuvent aider certains patients en renforçant la motivation et la gestion du stress.
Les applications mobiles, le e-coaching et les forums d’entraide constituent aussi des outils numériques intéressants, surtout chez les plus jeunes.
Suivi et prévention des rechutes
Importance du suivi régulier
Le suivi rapproché, notamment durant les premières semaines, est crucial. Il permet de prévenir les décrochages, d’ajuster les doses de substituts en fonction des signes de sous-dosage ou de surdosage, et de valoriser chaque progrès. Le renforcement positif – féliciter, encourager – est un levier essentiel pour maintenir l’abstinence.
Gestion des effets indésirables du sevrage
Irritabilité, troubles du sommeil, prise de poids, nervosité : ces effets secondaires peuvent décourager. Soyez attentif à ces signes de difficultés, rassurer vos patients, et proposer des solutions : activité physique adaptée, conseils diététiques (d’autant plus important que l’une des principales craintes concerne la prise de poids imputée à l’arrêt de la cigarette) —, relaxation.
L’accompagnement psychologique est essentiel pour limiter l’impact émotionnel.
Plan d’action en cas de rechute
Une rechute ne doit pas être considérée comme un échec : elle fait partie du processus. L’important est de comprendre les circonstances qui y ont mené (stress, soirée, manque de préparation), et de relancer une nouvelle tentative de sevrage. Les stratégies d’arrêt progressif, avec ajustement des substituts ou changement de méthode, permettent souvent de rebondir sans culpabilité.
Populations spécifiques et stratégies adaptées
Sevrage chez les femmes enceintes
Chez la femme enceinte, l’arrêt du tabac est impératif tant pour la santé du fœtus que de celle de la mère. Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits sous surveillance médicale sans risque fœtal. Un accompagnement spécifique et bienveillant est essentiel, en associant soutien psychologique et suivi obstétrical.
Sevrage chez les adolescents
Chez les jeunes, l’enjeu est souvent plus préventif que curatif (prévention primaire, sensibilisation). Les interventions doivent être adaptées : approche ludique, messages clairs, prise en compte de la pression sociale, des habitudes, de l’âge. Les outils numériques et les programmes scolaires peuvent être déterminants dans la décision du jeune et pour l’impliquer.
Sevrage chez les patients atteints de pathologies chroniques
Chez les patients BPCO, diabétiques ou atteints de cancer, l’arrêt du tabac est une urgence thérapeutique. Le suivi doit être renforcé, avec une coordination étroite entre spécialistes, infirmiers et kinés pour ajuster le traitement et soutenir l’adhésion du fumeur.
Personnes en situation de précarité ou avec troubles psychiatriques
Ces populations nécessitent un accompagnement renforcé : structures spécialisées, accès facilité aux substituts, suivi social et psychologique. Les équipes mobiles de santé et les associations jouent ici un rôle crucial.
| Depuis le 1er janvier 2019, le forfait d’aide au sevrage tabagique n’existe plus. Seuls les TNS inscrits sur la liste des substituts pris en charge sont remboursés sur prescription à 65 % par l’Assurance Maladie. Les médecins, sages-femmes, médecins du travail, chirurgiens-dentistes, infirmiers et kinésithérapeutes peuvent prescrire les traitements nicotiniques de substitution. |
Ressources et structures d’accompagnement
Services d’accompagnement
Tabac info service (3989, site, application) reste l’outil de référence, gratuit et accessible. Les réseaux régionaux de tabacologie et les centres hospitaliers spécialisés proposent des consultations individuelles ou collectives.
La médecine du travail peut aussi être un relais efficace, pour soutenir le sevrage sur le lieu de travail.
Formations et mise à jour des professionnels
La formation continue (DPC) vous permet d’actualiser vos connaissances, notamment sur la prescription de substituts et l’entretien motivationnel, afin d’offrir un accompagnement de choix, et sécuriser votre pratique.
Des ressources numériques et outils d’auto-support sont également disponibles pour les patients comme pour les soignants.
Pour conclure…
Le sevrage tabagique n’est jamais un chemin tout tracé.
C’est un combat quotidien contre une dépendance tenace, mais aussi une victoire possible à chaque étape franchie. Pour les soignants, l’enjeu est d’offrir plus qu’un protocole ou une ordonnance.
C’est une écoute, une présence, et un soutien ajusté aux réalités de chaque patient.
En mobilisant l’ensemble des ressources disponibles — traitements, accompagnement psychologique, structures spécialisées, relais associatifs ou numériques — et en plaçant la bienveillance au cœur de la relation, les professionnels deviennent de véritables partenaires de santé.
Parce qu’arrêter de fumer, ce n’est pas simplement se priver d’une cigarette : c’est se réapproprier son souffle, sa liberté, son avenir. Et grâce à l’engagement collectif, chaque patient peut croire qu’une vie sans tabac n’est pas seulement souhaitable, elle est possible.
Et vous, comment abordez-vous le sevrage avec vos patients ? Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ? Quels conseils donneriez-vous à vos collègues pour mieux accompagner les fumeurs dans leur sevrage.
Enfin, si vous avez trouvé cet article utile, n’hésitez pas à le partager autour de vous.
Sources :